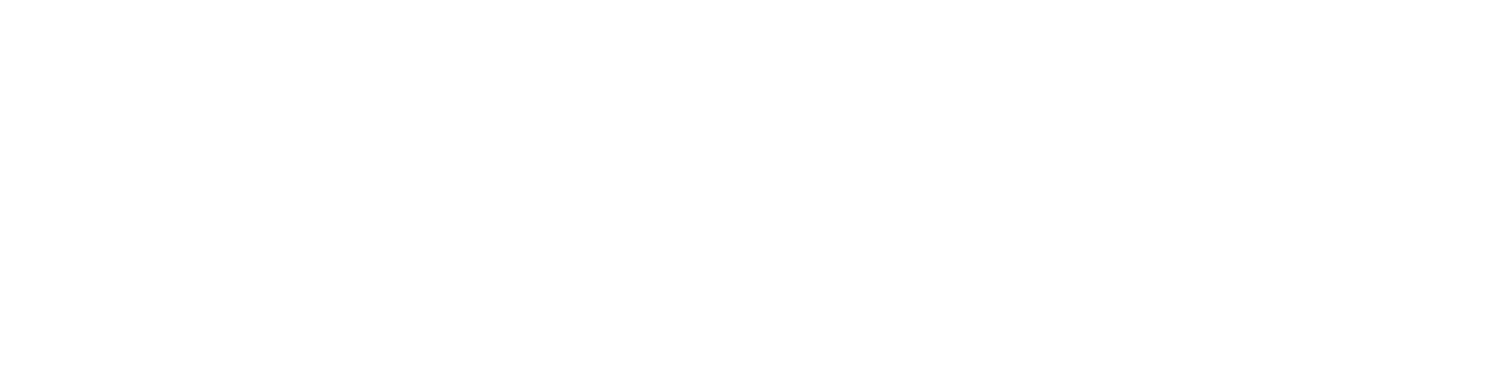La langue cède là où le vase se fissure
30/11/2020
Écrit par Timothée Chaillou
29 novembre – 13 décembre 2020, Galerie Cinéma (3 rue Pleney, Lyon, France)
Dans le cadre du programme DE:STRUCTURE.
Dans La propagation des fissures, Anna Viktorova ne présente pas le vase en céramique comme un objet stable, mais comme un site où la forme est exposée au stress de son propre devenir. Présentée dans le cadre de DE:STRUCTURE — un programme curatoriel réparti entre plusieurs institutions lyonnaises — cette exposition s'écarte de la logique de la structure comme cohérence, confinement ou lisibilité symbolique. Elle aborde plutôt la fracture comme une condition matérielle et une possibilité épistémique. Le vase ne cède pas sous la pression ; il articule un mode de résistance qui se manifeste par la désintégration.
Ces œuvres ne sont pas simplement fissurées. Elles sont structurées par la rupture — par ce que Bernard Stiegler appelle la désindividuation du matériau : le moment où la matière perd les coordonnées qui permettaient autrefois de la nommer, la classifier, la manipuler. Les formes en raku d'Anna Viktorova ne sont pas définies par l'intention, mais par l'interruption. Leurs surfaces boursouflent, s'écaillent ou se calcifient en réaction au feu, au stress minéral et à l'interférence chimique. Aucun geste de réparation n'est proposé. Au contraire, les œuvres gardent leurs plaies ouvertes — non pour dramatiser la blessure, mais pour laisser l'instabilité persister comme condition de la forme.
Il ne s'agit pas ici d'une romantisation de la ruine. Les œuvres résistent aux tropes visuels de l'entropie. Elles n'esthétisent pas la décomposition. Elles la métabolisent. Le processus de Viktorova intervient à l'échelle moléculaire, là où l'argile, la glaçure et les débris carbonisés ne fonctionnent plus comme des éléments de composition mais comme des agents porteurs de temps. Dans le langage de François Jullien, ces objets opèrent selon une logique de la transformation silencieuse — une transformation qui ne se manifeste ni par le climax ni par la résolution, mais qui continue imperceptiblement à travers la matière, l'oxydation, l'absorption atmosphérique. L'objet n'est pas fabriqué ; il est encore en devenir, encore en dégradation, encore en train de modifier les conditions de sa visibilité.
Il n'y a pas d'état fixe à contempler. Ce que l'on rencontre, ce sont des restes minéralisés de processus thermochimiques en cours. L'utilisation des cendres par Viktorova — issues de relations consumées, de déchets industriels, de mycéliums dégradés et de résidus synthétiques — rend littérale la transmutation de l'affect en matière. Ce ne sont pas des matériaux référentiels ; ce sont des résidus. Le vase, en conséquence, n'est pas une image du deuil, mais son expression tactile. Il ne contient pas le chagrin comme contenu ; il l'émet par chaque fissure, chaque variation de teinte, chaque arête volatile.
Parler de ces œuvres comme de la céramique revient à risquer une erreur de nomination. Elles ne participent pas aux conventions disciplinaires de la sculpture ou de l'artisanat. Elles existent à la limite du contenant, où l'objet cuit n'est plus une forme achevée mais une exposition suspendue. Dans le vocabulaire conceptuel de Catherine Malabou, elles incarnent une plasticité destructrice : non pas le changement comme réorganisation, mais comme rupture irréversible — une forme qui ne peut plus revenir à ce qu'elle était, ni s'intégrer à une narration cohérente. Les vases de Viktorova n'évoluent pas ; ils se brisent. Et cette brisure devient la source de leur force.
Ce refus de l'intégrité opère non seulement dans l'objet, mais dans son déploiement temporel. L'oxydation n'est pas un effet secondaire mais une tactique compositionnelle. Les surfaces changent de couleur après l'installation ; les fissures s'élargissent ; des traces métalliques apparaissent ou se dissipent. L'œuvre résiste à la logique muséale. Elle résiste à la conservation. Elle résiste à l'idée même de stabilité. Ce sont des objets qui exigent la proximité, non par l'intimité, mais par la volatilé. Ils ne s'offrent pas au regardeur ; ils se modifient sous son souffle, sa lumière, son temps.
Le titre de l'exposition, La propagation des fissures, est issu de la mécanique des fractures — une discipline qui étudie le mouvement des fissures dans les corps soumis à des contraintes. Dans la pratique de Viktorova, il acquiert des significations supplémentaires : psychologiques, affectives, archivales. La fissure devient un dispositif narratif qui refuse la narration ; c'est ainsi que la perte migre à travers les formes, que la mémoire se diffuse sans cohésion. La conception du fragment selon Jean-Luc Nancy est utile ici — non comme ce qui reste après le tout, mais comme un mode d'existence antérieur à toute totalité. Dans La propagation des fissures, le fragment n'est pas un déficit ; il est génératif. La fissure ne signifie pas l'absence. Elle constitue l'ontologie de l'œuvre.
Ce qui devient le plus manifeste, c'est l'adhésion de Viktorova à l'inachèvement. Les pièces ne sont pas complétées, mais suspendues, exposées, déjà en décomposition. Certaines frôlent l'effondrement mais ne cèdent pas. D'autres conservent leur forme uniquement pour rendre plus visible son délitement. Ce ne sont pas des métaphores de la vulnérabilité. Ce sont des opérations de pensée matérielle. La fissure n'interrompt pas le sens ; c'est là que le sens s'interrompt lui-même — là où la langue cède sous le poids de ce qui ne peut être systématisé.
En ce sens, les vases de Viktorova ne parlent pas du traumatisme — ils parlent depuis celui-ci. Sa pratique ne représente pas les suites d'un événement ; elle participe à la continuité de la rupture. Le four, entre ses mains, devient non pas un lieu de création mais d'événement — là où les matériaux rencontrent la force sans résolution. Il n'y a ici ni guérison, ni retour, ni réparation symbolique. Seulement la propagation de ce qui refuse de se refermer.
La propagation des fissures occupe ainsi un territoire conceptuel qui échappe aux taxonomies de la tradition céramique comme de la sculpture contemporaine. Elle propose une autre logique : celle dans laquelle la matière témoigne de sa propre déconstruction, et où le vase, en se fissurant, affirme une vérité qu'aucune forme intacte ne saurait porter.
Timothée Chaillou est un critique d'art indépendant et commissaire d'exposition. Il est membre de l'AICA (Association Internationale des Critiques d'Art), de l'IKT (Association Internationale des Commissaires d'Art Contemporain), du CEA (Commissaires d'Exposition Associés) et de la Société Française d'Esthétique. Il est rédacteur en chef du ANNUAL MAGAZINE No 5.