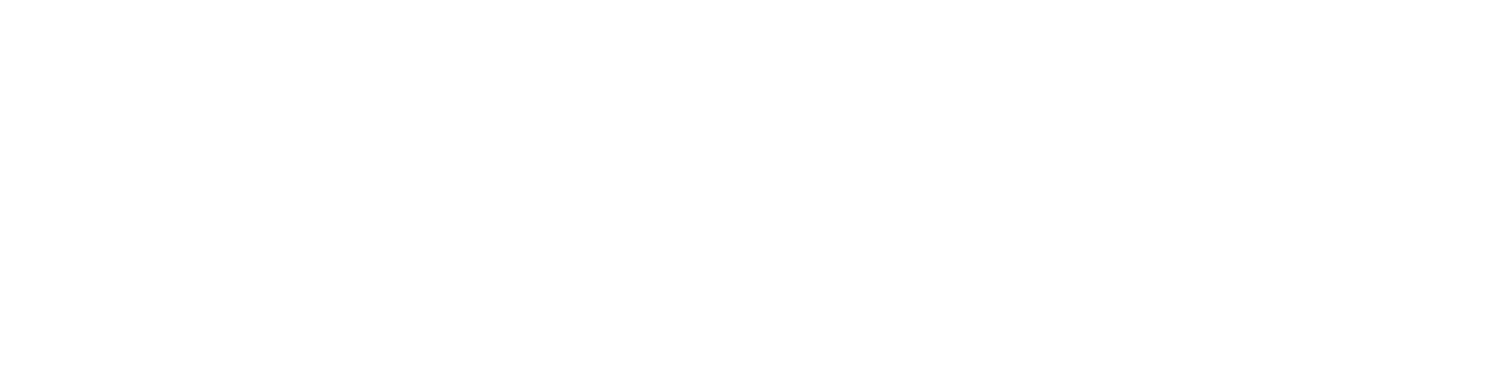Leçons d’une porte fermée
22/10/2024
Écrit par Timothée Chaillou
Dès l’entrée dans ‘Bloc C : Syntaxe de l’obstruction’ à la Galerie Cinéma de Lyon, on se retrouve face à une structure saisissante et imposante — une installation sculpturale vaste et industrielle, à la fois familière et totalement étrangère. L’artiste ukrainienne installée au Royaume-Uni confronte le spectateur à une énigme architecturale, non pas à résoudre, mais à travers laquelle se révèle la violence de l’incohérence. Elle s’inscrit ainsi dans une tradition bien établie de l’art contemporain et de la philosophie française, où les institutions — qu’elles soient architecturales, idéologiques ou épistémologiques — sont interrogées, déstabilisées, puis déconstruites.
‘Bloc C’ ne propose ni clarté ni compréhension. Il fonctionne comme une obstruction, refusant l’accès, rejetant l’élan du spectateur à comprendre ou parcourir sa forme. Construit en résine composite, aluminium et panneaux en mousse imitant le béton brutaliste, l’ensemble évoque visuellement les lycées emblématiques des années 1970 — symboles d’une époque où l’État français affirmait son autorité par l’éducation publique. Mais dans les mains de l’artiste, ces formes ne sont plus des icônes de confiance ou d’ordre institutionnel. Elles deviennent des monuments de l’échec, où chaque élément architectural — porte, escalier, fenêtre — devient un geste inachevé. Ils invitent à l’interaction, mais ne mènent nulle part ; toute tentative d’engagement ne fait qu’amplifier la confusion.
‘Bloc C’ partage une parenté critique avec les artistes et penseurs français qui ont interrogé l’espace institutionnel et le langage, notamment au croisement de l’architecture et du savoir. On pense immédiatement aux critiques post-structuralistes du pouvoir institutionnel et du langage, incarnées par Michel Foucault et Jacques Derrida, dont les idées sur la discontinuité, l’échec et l’instabilité du sens sont profondément perceptibles ici. Pour Foucault, les espaces institutionnels — écoles, prisons, hôpitaux — étaient des outils biopolitiques destinés à discipliner et à contrôler. L’artiste va plus loin encore : elle n’interroge pas seulement ces lieux, elle leur donne forme dans leur effondrement.
Comme Foucault analysait l’architecture du Panoptique — la prison pensée pour surveiller depuis un point central — ‘Bloc C’ rend sensible l’échec de cette surveillance et la désintégration de l’ordre institutionnel. Là où Foucault décrivait un regard omniprésent, cette œuvre propose un monde où ce regard a échoué, où l’architecture ne clarifie plus rien, mais désoriente. La structure, par ses mouvements et son refus de toute fonction explicite, mime la désintégration philosophique même de l’idée de pouvoir institutionnel. Le spectateur se retrouve sans repères, abandonné dans un espace qui résiste à toute catégorisation — métaphore d’un effondrement de la pensée ordonnée.
La déconstruction et la faillite du langage, telles que pensées par Derrida, trouvent aussi écho dans ‘Bloc C’. Selon Derrida, les structures hiérarchiques du langage sont toujours instables ; le sens est différé, jamais fixé. Ici, l’architecture elle-même devient texte instable. Les portes qui ne s’ouvrent pas, les escaliers qui ne montent pas, les murs qui ne séparent rien, reflètent cette idée que le langage ne peut jamais pleinement représenter ce qu’il vise. L’installation incarne physiquement cet échec : chaque tentative d’« ouvrir » ou de « comprendre » ne fait que produire davantage de contradiction.
L’interaction entre langage et espace évoque également les recherches d’artistes français contemporains tels que Daniel Buren et Pierre Huyghe. Buren, avec ses bandes et ses couleurs dans l’espace public, cherche à déstabiliser la perception de l’architecture et à révéler ses structures sociales cachées — une logique que l’on retrouve dans les formes fragmentées de ‘Bloc C’. À l’instar de Buren, l’installation perturbe l’ordre spatial de l’architecture civique elle-même, forçant le spectateur à questionner la fonction du bâti public — qu’il soit éducatif, culturel ou administratif.
De même, les expérimentations de Pierre Huyghe avec l’instabilité temporelle et les expériences non linéaires résonnent fortement avec le rejet de la permanence dans ‘Bloc C’. L’artiste, comme Huyghe, crée des situations d’incertitude. En interagissant avec la structure — en déplaçant des panneaux ou en tentant d’ouvrir une porte fermée — le spectateur ne prend pas le contrôle mais rencontre une résistance. Il ne domine pas l’œuvre, il est désorienté par elle. Il n’y a pas de lecture définitive, seulement une implication qui engendre de nouvelles incertitudes.
‘Bloc C’ est donc à la fois une critique spatiale et une réflexion sur les limites du savoir institutionnel. Dans les années 1960 et 1970, le philosophe Gaston Bachelard affirmait que l’espace façonnait la pensée. Ici, cette idée est inversée : l’espace ne façonne plus la pensée — il la dissout. Les visiteurs sont invités à remettre en cause la fonction même de l’espace architectural : lieu jadis d’apprentissage, d’organisation, il devient désormais espace de confusion totale, où le sens est bloqué à chaque tournant.
En définitive, ‘Bloc C : Syntaxe de l’obstruction’ est une rupture autant physique qu’intellectuelle. L’artiste a construit un monument à l’échec — un échec qui reflète l’effondrement des systèmes mêmes de contrôle, d’ordre et d’éducation sur lesquels s’est fondée la modernité. En faisant de l’architecture non un objet à observer mais un agent de sa propre déconstruction, elle force le spectateur à engager une relation radicalement nouvelle avec l’espace et le langage : non comme objets de compréhension, mais comme expériences à vivre, à mal comprendre, et enfin, à désapprendre.
Timothée Chaillou est un critique d'art indépendant et commissaire d'exposition. Il est membre de l'AICA (Association Internationale des Critiques d'Art), de l'IKT (Association Internationale des Commissaires d'Art Contemporain), du CEA (Commissaires d'Exposition Associés) et de la Société Française d'Esthétique. Il est rédacteur en chef du ANNUAL MAGAZINE No 5.