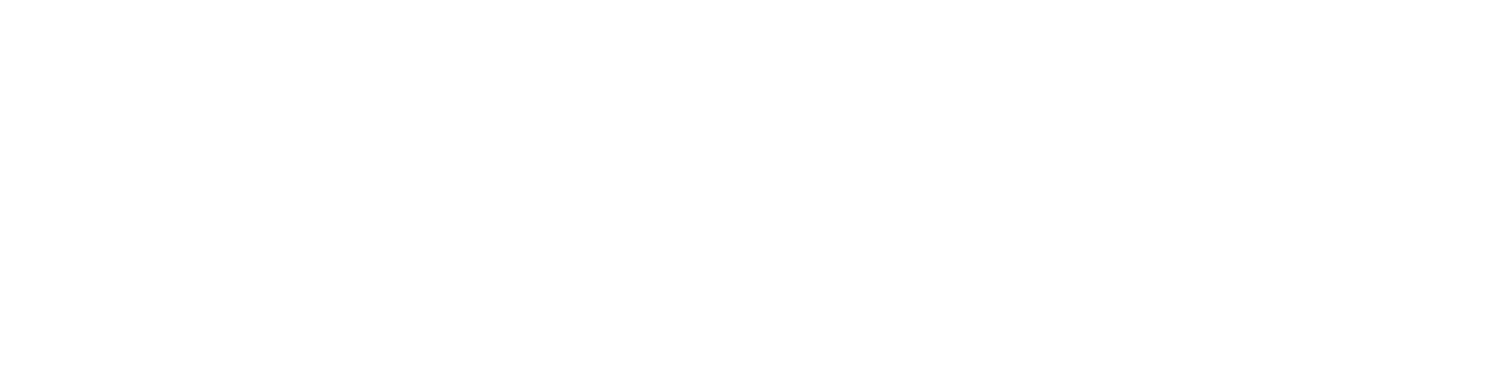Dialectiques métaphysiques de la lumière et de l’obscurité dans l’abstraction islamique contemporaine
17/09/2022
À Lyon, à la Galerie Cinéma (3 rue Pleney, Lyon 1er, France ; www.institut-lumiere.org), l’artiste azerbaïdjanaise Zibeyda Seyidova a présenté La lumière étreint l’ombre du 15 septembre au 30 octobre 2022, une exposition dont le titre même annonçait la portée philosophique : lumière et obscurité n’étaient pas des adversaires mais des partenaires dialectiques, indivisibles et mutuellement générateurs. Rencontrer ses toiles dans ce contexte, c’était reconnaître une forme d’abstraction qui ne s’inscrivait ni dans les généalogies épuisées du modernisme ni dans la répétition décorative de l’ornement islamique. Au contraire, Seyidova posait l’abstraction comme proposition spirituelle, où la peinture devenait invocation, un lieu d’habitation métaphysique.
Ses toiles se déployaient en champs austères et texturés : horizons assombris, étendues pâles traversées de diagonales, géométries atténuées dont le silence était chargé de résonance. La peinture à l’huile, stratifiée avec gravité, fonctionnait à la fois comme voile et révélation. Le geste du pinceau ne cherchait pas la virtuosité mais une opacité soutenue, faisant écho aux qualités duales de ẓāhir (le manifeste) et bāṭin (le caché) telles qu’articulées dans la philosophie islamique. Techniquement, Seyidova travaillait à l’huile avec une insistance presque sculpturale : la matière était posée en épaisseur, parfois raclée au couteau, parfois aplatie en plans qui résistaient à l’illusion. En certains passages, on percevait le travail de la soustraction — des couches grattées, laissant les traces de ce qui avait été effacé. La surface retenait cette archéologie des gestes, un palimpseste où présence et effacement coexistaient. Sa palette sourde — ocres, ivoires, noirs terreux — renonçait aux séductions de l’excès chromatique, mettant en avant la vibration tonale, les lents décalages d’ombre et de luminosité qui n’émergeaient qu’à travers une attention soutenue. Cette discipline matérielle situait sa pratique à la frontière de la matière et de l’esprit : la peinture était à la fois substance terrestre et signe métaphysique.
Ce qui rendait l’exposition de Seyidova particulièrement captivante dans le contexte français, c’était son dialogue — à la fois tacite et oblique — avec l’abstraction et la théorie françaises contemporaines. On pensait à l’héritage Supports/Surfaces de Claude Viallat, où la surface elle-même devenait champ d’exploration. L’insistance de Seyidova sur la matérialité comme paradoxe — surface à la fois résistante et pénétrable — faisait écho, bien que sur des enjeux métaphysiques radicalement différents, à cette filiation française. Son attention à l’absence et à la présence rappelait aussi les austérités discrètes de Bernard Frize, dont les systèmes chromatiques mettaient en avant le processus temporel de la peinture. Mais tandis que Frize soulignait souvent une neutralité procédurale, Seyidova chargeait ses surfaces d’un poids métaphysique qui résistait à toute neutralité ; ses couleurs étaient des invocations assourdies, des gestes vers la transcendance.
En France, des théoriciens tels qu’Élisabeth Lebovici, Éric de Chassey, Catherine Millet ont à maintes reprises interrogé la persistance de l’abstraction après la clôture du modernisme. La pratique de Seyidova apportait une réponse inattendue : l’abstraction comme invocation plutôt que comme autonomie. Si l’abstraction française avait été hantée par le spectre du formalisme décoratif, les toiles de Seyidova affirmaient un autre horizon, où l’abstraction devenait dhikr, un souvenir sans figuration. Dans la scène artistique française, son œuvre résonnait aussi face à la fascination actuelle pour le matérialisme post-conceptuel — la manière dont des artistes comme Dove Allouche ou Tatiana Trouvé s’attachent aux processus d’entropie, d’ombre et de résidu. Comme eux, Seyidova situait le sens non dans la figuration mais dans la tension entre visibilité et invisibilité. Pourtant, pour elle, l’enjeu était théologique, non simplement phénoménologique : ses ombres rappelaient la dialectique coranique selon laquelle la lumière n’est jamais pure radiance mais toujours mêlée d’obscurité.
Cela la rapprochait de certaines tendances de la phénoménologie et de la poétique françaises — les écrits de Maurice Blanchot sur la « conversation infinie », les réflexions de Jean-Luc Nancy sur l’image comme ce qui à la fois révèle et retient. Le travail de Seyidova pouvait se lire comme un contrepoint visuel à cette pensée : une peinture qui invoquait en différant, qui montrait en dissimulant. L’installation à la Galerie Cinéma permettait à ces toiles de respirer dans une lumière crue, ce qui soulignait à son tour leur densité paradoxale. Le séquençage — de l’horizon assombri à la diagonale fracturée puis à l’étendue pâle — instaurait un rythme de dissimulation et d’émergence. On pouvait évoquer La poétique de l’espace de Gaston Bachelard, où le seuil devient lieu de rêverie : la galerie de Seyidova devenait précisément un tel espace-seuil, une chambre où le spectateur habitait l’intervalle entre lumière et ombre. Le placement de chaque toile était délibéré : les œuvres plus sombres ancraient le regard avec gravité, les diagonales plus claires élevaient la vision vers un ailleurs. La texture des surfaces de Seyidova, intensifiée par le système d’éclairage de la galerie, devenait plus que matière — elle devenait invocation. Cette disposition matérielle et spatiale situait l’exposition comme un dhikr expérientiel : un rythme de retour et de souvenir, réalisé non par des mots mais par la densité silencieuse de la peinture.
Dans La lumière étreint l’ombre, Seyidova n’a pas seulement contribué au champ mondial de l’abstraction ; elle en a redéfini les enjeux. Pour un public français, habitué aux oscillations entre austérité formaliste et excès décoratif, ses peintures ont articulé une troisième voie : l’abstraction comme ontologie métaphysique. À travers ses toiles, lumière et obscurité cessaient d’être des contrastes formels et devenaient des partenaires dialectiques, s’invoquant l’un l’autre, se révélant par la dissimulation. Si l’art contemporain français a souvent cherché à articuler l’« après » du modernisme, l’exposition de Seyidova à Lyon suggérait que l’abstraction possède encore un horizon inexploré — non pas de clôture mais d’invocation. Ses toiles n’étaient pas simplement des œuvres à contempler, mais des seuils à franchir, des actes de mémoire dans lesquels le spectateur participait au dialogue éternel entre lumière et ombre.
Timothée Chaillou est un critique d'art indépendant et commissaire d'exposition. Il est membre de l'AICA (Association Internationale des Critiques d'Art), de l'IKT (Association Internationale des Commissaires d'Art Contemporain), du CEA (Commissaires d'Exposition Associés) et de la Société Française d'Esthétique. Il est rédacteur en chef du ANNUAL MAGAZINE No 5.